




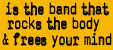
Avant d'être un groupe d'Afrobeat, le
ghetto blaster
est le terme qui désigne le poste de musique portatif bien connu aux États-Unis.
> Leur histoire
L'aventure de Ghetto Blaster démarre en 1983, lorsque deux musiciens français (Romain Pugebet et Stéphane Blaes) demandent à Pascal Imbert de les produire. Celui-ci décide alors d'aller avec eux à Lagos (Nigeria) en voiture afin d'y faire un disque avec des musiciens qu'il connait là-bas.
Ce voyage entre Paris et Lagos a été filmé sous forme de documentaire musical par Stéphane Meppiel (producteur- réalisateur), François Kotlarski (cameraman) et Éric Munch (prise de son) ; Martin Meppiel, Isabelle Soto et Nathalie Vierney se joindront aussi dans l'aventure.
Là-bas, Kiala Nzavotunga (guitare et chant lead), Ringo Avom (batterie) et Udoh Essiet (percussions) - d'anciens musiciens de Fela & Egypt 80' -, vont se joindre aux français, ainsi que Betty Ayaba (chanteuse) et Willy N'for (basse et chant lead) - lui-même musicien de Sonny Okossun à l'époque -. Après quelques mois passés à jouer leur musique afrobeat-afrofunk au Black Pussy Cat, bar nigérian où l'on passe la nuit à danser sur de la musique juju et de l'afrobeat, les Ghetto Blaster décident de tenter l'aventure en Europe.
Ils arrivent à Paris en 1983, sur la péniche de Stéphane Meppiel, "Chine", amarrée à Nogent-sur-Marne (94). Devenue lieu de vie et studio de répétition pour le groupe, leur péniche s'installe à Paris en 1984, le long de la gare d'Austerlitz. Le film de leur aventure est diffusé sur Antenne 2 en 1984.
Cette même année, Ghetto Blaster sort Preacher Man/Efi Ogunle, un maxi 45T chez Island, label de Chris Blackwell.
En 1985, Ghetto Blaster sort l'album People chez Mélodie (producteur exécutif Jacques Goldstein). Cet album, enregistré et mixé en cinq jours au studio Marcadet (Paris), fera connaître la musique Afrobeat à un plus large public. Ils effectuent alors une tournée à travers les États-Unis en 1988 - notamment à Boston, New York, Miami et Los Angeles -, et joueront avec les plus grands, effectuant les premières partie de Fela Kuti, Kool & the Gang, Archie Shepp, James Brown, Maceo Parker et Manu Dibango.
À la fin des années 80, la disparition de la chanteuse Betty Ayaba, puis celle du bassiste Willy N'for en 1997, séparera momentanément le groupe, chacun suivant ses projets personnels.
En 1999, après un long silence, les Ghetto Blaster se reforment. Ils sont représentés maintenant par trois membres : Kiala Nzavotunga (membre fondateur, guitariste et lead vocal), Frankie Ntoh Song (membre fondateur, clavier et chant) et Myriam Betty (chanteuse qui a rejoint le groupe à leur arrivée en France).
Leur concert de "come back" eu lieu en 1999, à l'African Festival de Delft (Pays-Bas).
En 2002, l'album People est réédité en vinyl par Follow Me Records.
En 2003, Ghetto Blaster fête ses 20 ans et la sortie de l'album River Niger, chez Next Record et distribué par Next Music. Il est produit par Stéphane Blaes et Kiala Nzavotunga.
> Leur musique (texte écrit par Nazaire Bello)
Les ghetto blaster continuent d'entretenir la flamme Afrobeat brûlée plus d'un quart de siècle par le godfather Fela Kuti.
D'abord ce sont des riffts géants, des rythmiques frénétiques coulées dans le jazz, le funk, le rock, le rhytm'n'blues et la soul. Leur afrobeat spécifique et moderne démontre qu'ils demeurent les pionniers de l'afro rock et l'afro jazz en Europe.
Les voix de l'african beat ne s'éteignent jamais. Il faut dire que le groupe avait entraîné la déferlante afrobeat dans son sillage en Europe, notamment dans les années 80 avant de connaître un répit, pour nous revenir de plus belles manières, grâce à un troisième album sortie en 2003, et surtout côté scène, où il continue de chauffer sa fusion de style en martelant un groove explosif.
Tout en conservant les secrets du temple afrobeat, les ghettos proposent un prolongement vers d'autres horizons sans confusion du genre en impulsant une énergie nouvelle qui prend des accents Rock'n'Funk'n'Blaster. Leur dernier album l'atteste. Il symbolise leur voyage et leur maturité. Les envolées lyriques de "Batu Mwindu" vous transportent vers le Zaïre. "Je m'appelle Kiala" est un morceau frais et très ouvert. Il est l'invitation à la fête entre amis. Après quelques escapades, nous revenons aux fondamentaux car "Reality" prouve bel et bien que la réalité de l'afrobeat est toujours détonante.
Le groupe qui n'a à son actif que deux albums, démontre une qualité sans cesse grandissante. Gageons que les temps à venir nous gratifient de productions somptueuses synonymes de consécration de beaux efforts.







